Pinède de Juan, jeudi 10 juillet vers 16 h 30. Après le soundcheck, les musiciens sont rentrés à l'hôtel ou ont filé à la plage. James Blunt traîne dans le backstage avec sa copine, en attendant la télé et les journalistes qu'il a accepté de rencontrer avant son concert du soir. En jean, tennis et tee-shirt gris, on le confondrait aisément avec l'un des jeunes roadies qui travaillent au montage des lumières et de la sono et viennent périodiquement se ravitailler au frigo du catering. Pour l'avoir croisé en janvier aux NRJ Awards de Cannes, papotant avec ses potes sur la terrasse du palais des Festivals en attendant son tour, on savait le garçon particulièrement cool et avenant. On s'attendait quand même à le trouver plus tendu à quelques heures de son premier concert (complet) dans la Pinède Gould, qui a vu passer les plus grands noms du jazz et du blues. Pas du tout : James se ballade comme chez lui entre les algecos qui forment le backstage, discute avec tout le monde, choisit sa tenue de scène en trente secondes, s'excuse de devoir nous faire patienter pour enregistrer son interview avec France 2 et France 3, qui ont des impératifs horaires plus serrés, promet de revenir vite et le fait effectivement, se présente aux retardataires (« Hello, I'm James »), s'assied, relève ses lunettes de soleil sur le front, sourit et attend les questions. La première, évidemment, tombe un peu à plat vu la décontraction du personnage...
Quel effet cela vous fait-il d'être la tête d'affiche d'un des plus grands festivals de Jazz du monde et de voir votre nom succéder à ceux de Miles Davis ou de Keith Jarrett ?
C'est un feeling assez spécial, évidemment, mais je suis surtout séduit par l'endroit qui est vraiment magnifique. Pour moi, la musique ne se catégorise pas. La bonne musique, c'est la bonne musique : que ce soit du jazz ou de la pop importe peu. Je ne vais pas me mettre à jouer « Beautiful » avec des arrangements jazzy, juste parce que je suis dans un festival de jazz. Par contre, comme le show est différent tous les soirs en fonction du public que l'on a en face, je suis curieux et impatient de voir ce que va nous renvoyer celui de cette pinède...
Pour un Anglais, jouer à la Tour Eiffel pour le 14 juillet, ce sera aussi « assez spécial », non ?
Oui, c'est un honneur que l'on me fait. Sans doute que je devrais chanter quelque chose en français, non ? « Frère Jacques », peut-être, c'est la seule que je connaisse (rires)
On s'étonne de la simplicité avec laquelle vous semblez gérer votre phénoménal succès. Comment faites-vous ?
C'est un peu facile de croire que le succès est venu très vite. Je n'ai pas 19 ans, non plus ! J'ai commencé la musique à neuf ans, j'ai attaqué la guitare à douze, j'ai signé mon premier contrat d'artiste à dix-neuf, mais il m'a fallu attendre jusqu'à 27 ans pour publier mon premier disque et avoir du succès. Ca a été un plus long chemin qu'on ne le croit. Et puis, tout dépend de ce que l'on considère comme « le succès ». J'ai un ami qui vit dans une caravane avec sa femme et ses deux enfants, personne ne le connaît, il ne gagne pas énormément d'argent, mais chaque fois que je le vois il a le sourire aux lèvres et je sais qu'il est parfaitement heureux. Pour moi, c'est ça le succès. Je n'ai pas fait ce métier pour être une megastar et gagner des millions. Pouvoir vivre gentiment de ma musique m'aurait suffi
Vous étiez militaire, qu'est-ce qui vous a décidé à quitter l'armée pour la musique ?
Écrire des chansons et les chanter devant un public, c'est quand même le plus beau métier du monde, non ? Il y a deux ans, je suis retourné au Kosovo, où j'avais servi pour l'ONU, mais pour chanter, cette fois. Pendant deux heures, j'avais devant moi des gens qui se sont entre-tués pendant la guerre civile et qui chantaient et dansaient à l'unisson. Cela aucun militaire, aucun politicien, ni même aucun autre artiste qu'un chanteur ne peut le réaliser.
Vous avez grandi dans les années 80, comment se fait-il que votre musique s'inspire tellement de la décennie précédente et si peu de celle-là ?
Dans ma famille, on écoutait les Beatles et les Beach Boys. J'ai commencé par là et puis j'ai continué avec David Bowie, Elton John, Lou Reed, Leonard Cohen. Tous les grands « song writers » étaient au sommet de leur art dans les années 70. Leur musique a traversé le temps, sans doute parce qu'elle était faite avec le cœur et très peu de machines. J'essaie de retrouver cette dimension « humaine » avec mes chansons et mes musiciens.
Pourtant, vous êtes plus généralement considéré comme un chanteur romantique que comme un auteur. Cela vous attriste ?
Ce sont les médias qui me présentent comme cela parce que « chanteur romantique », c'est plus vendeur comme catégorie qu' « auteur ». Je ne suis pas certain que mon public pense la même chose de mon travail. Il y a, en tout, quatre chansons d'amour sur mes deux disques. Et ce sont des amours ratées. Bonjour le romantisme ! (rires). Toutes les autres parlent de la guerre, de l'amitié, de la religion, de la vie en général, mais curieusement on ne retient que les chansons d'amour...
Quelle direction cela vous inspire-t-il pour la suite de votre carrière ?
Le deuxième album a été plus difficile à écrire que le premier. Il y avait une attente particulière que je me suis efforcé de satisfaire. Pour le troisième, je me sens tout à fait libre d'explorer d'autres directions. Sur cette tournée, la musique est plus rock. Je joue une reprise des Pixies, il y a pas mal de guitare électrique, du piano, de l'orgue Hammond. Le public, qui s'attend peut-être à me voir chanter seul avec une guitare acoustique, est surpris. Cela me plaît bien. Je verrais bien le prochain disque sonner comme ça, plus « live ».
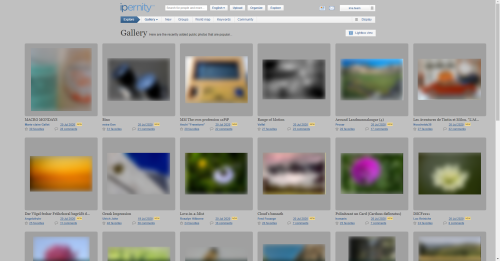
Sign-in to write a comment.